COP15, TNDF, Tax4... Un nouveau cadre pour la biodiversité
Après le changement climatique, un nouveau cadre global pour la biodiversité
C’est déjà une évidence pour la plupart d’entre nous : si l’humanité souhaite ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et continuer de vivre durablement dans un écosystème sûr, elle devra s’engager à respecter les neuf principales limites planétaires (Rockström et al., 2009). Parmi ces limites, le changement climatique, bien-sûr. Contrairement aux autres limites planétaires, c’est le thème qui bénéficie de la plus grande visibilité et qui recueille le plus d’intérêt et d’engagement de la part des entreprises financières et non financières. Cette prise de conscience s’est notamment accélérée depuis l’Accord de Paris de la COP 21 de novembre 2015, un accord qui résulte d’un succès diplomatique et médiatique sans précédent en ce qui concerne les conférences des parties (COP) de l’ONU sur le sujet des changements climatiques.
L’une des particularités de la COP21, qui lui a permis d’aboutir à l’Accord historique de Paris, a été la mise en avant à une échelle globale d’une approche pragmatique de la problématique climatique afin que celle-ci puisse facilement et rapidement être intégrée par l’ensemble de la communauté internationale. Cette approche pragmatique peut être résumée de la manière suivante :
“Une concentration atmosphérique dans l’atmosphère de gaz à effet de serre trop élevée mène à un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique doit être limité à 1,5°C ou 2°C. Pour cela, les émissions de ces gaz doivent cesser le plus vite possible afin de limiter cette concentration atmosphérique.”
Le fait de pouvoir aujourd’hui résumer la problématique du changement climatique de façon si simplifiée est le résultat du travail d’une large communauté scientifique spécialisée sur le sujet (le GIEC) qui est en mesure d’expliquer cette problématique de façon de plus en plus précise. Cela est également dû au succès de la COP21 qui a vulgarisé cette problématique et l’a très largement véhiculée à travers la planète. La problématique du changement climatique est aujourd’hui cadrée. Un objectif commun a été défini et le progrès des différents acteurs de la société vis-à-vis de cet objectif peut être mesuré.
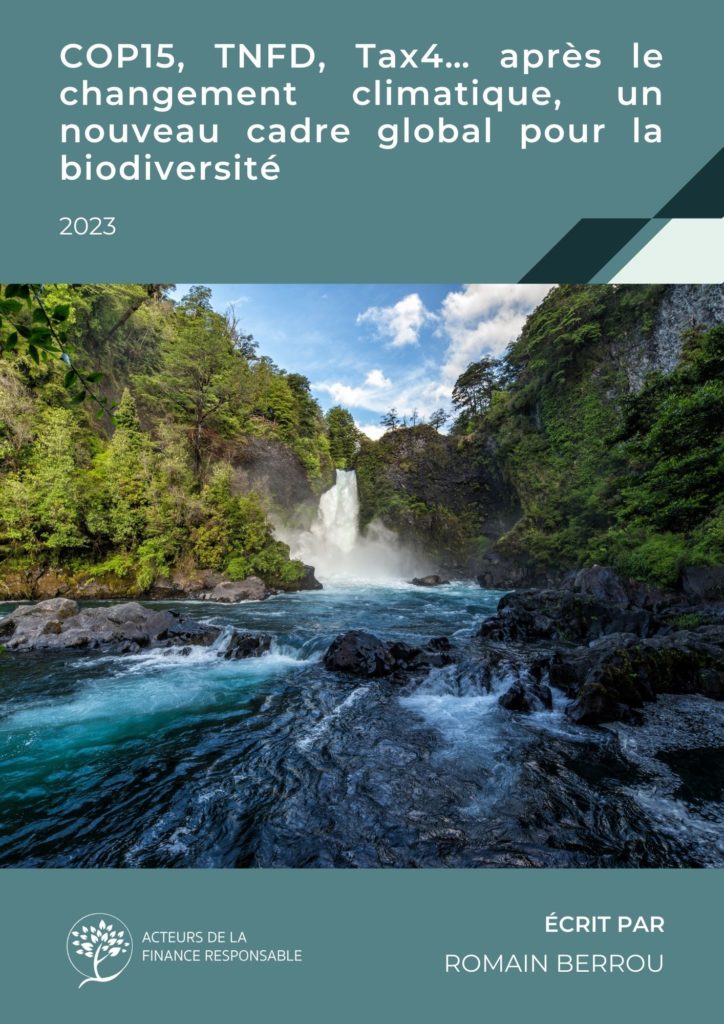
Envie de lire la suite?
Découvrez l’article complet rédigé par Romain Berrou, en partenariat avec l’association Les Acteurs de la Finance Responsable (AFR).

Romain Berrou
Membre ambassadeur
